© 2023 Kreativa. All rights reserved. Powered by JoomShaper

La Vérité à l’Épreuve du Temps : Un dialogue entre la pensée d’un philosophe ivoirien et les promesses technologiques
Dédicace
À celles et ceux qui doutent, qui questionnent, qui résistent à l’engouement technologique sans critique —
Cet éditorial est dédié aux sceptiques de l’intelligence artificielle. Non pour les convaincre de s’y soumettre, mais pour reconnaître la valeur de leur vigilance. Car c’est par le doute que la vérité respire, et par la pensée critique que la technologie reste un outil — non une idole.
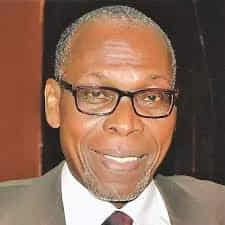 Notre réflexion sur la nature de la vérité trouve son origine dans l’aphorisme percutant du Professeur Paul Zahiri, politologue et philosophe ivoirien. Intellectuel engagé, dont les analyses fines sur la politique africaine et les grandes questions philosophiques résonnent puissamment dans les débats contemporains, le Professeur Zahiri nous interpelle avec une sentence d’une lucidité saisissante :
Notre réflexion sur la nature de la vérité trouve son origine dans l’aphorisme percutant du Professeur Paul Zahiri, politologue et philosophe ivoirien. Intellectuel engagé, dont les analyses fines sur la politique africaine et les grandes questions philosophiques résonnent puissamment dans les débats contemporains, le Professeur Zahiri nous interpelle avec une sentence d’une lucidité saisissante :
« La vérité est liée à l’homme, or il est mortel. Il n’y a donc pas de vérités éternelles, mais des vérités transmissibles. »
Ce choix de convoquer la pensée du Professeur Zahiri repose sur plusieurs raisons. Tout d’abord, son propos s’inscrit dans un débat philosophique universel sur la nature et la pérennité de la vérité, en y apportant une perspective africaine précieuse, trop souvent absente dans un champ dominé par les traditions occidentales. Ensuite, à l’heure où l’information circule de manière fulgurante et où les faits eux-mêmes sont remis en question, son regard sur le caractère construit et transmissible de la vérité acquiert une portée particulière. Enfin, la densité et la clarté de son aphorisme en font un socle idéal pour nourrir une réflexion contemporaine, notamment à l’ère des avancées technologiques.
C’est précisément cette articulation entre vérité, transmission et technologie que nous souhaitons explorer ici. L’ingéniosité humaine, dans son élan de dépassement de soi, nous propulse vers des perspectives technologiques vertigineuses. Parmi elles, la possibilité d’une préservation numérique quasi absolue, où l’ensemble du savoir humain serait archivé dans des infrastructures aux capacités de stockage et de longévité inédites. Des initiatives comme Internet Archive ou les bases de données massives d’instituts de recherche nourrissent cette vision. Dans ce scénario, la vérité semble pouvoir s’émanciper des fragilités biologiques de l’homme et de la corrosion du temps.
Des intelligences artificielles avancées, capables de vérifier, consolider et perpétuer ces connaissances, pourraient devenir les gardiennes d’une cohérence factuelle durable. Plus loin encore, certains imaginent des formes de transmission directe de la connaissance, entre cerveaux ou consciences interconnectées, faisant émerger l’idée d’une vérité affranchie des contingences corporelles.
Mais ces projections, aussi séduisantes soient-elles, soulèvent des interrogations philosophiques fondamentales.
Une vérité conservée dans le silicium ou traitée par des algorithmes demeure-t-elle vivante ? Peut-elle encore être qualifiée de « vérité » si elle est coupée du contexte humain, de l’expérience vécue, de l’interprétation critique ? La connaissance ne vit-elle pas précisément grâce à son instabilité, à sa remise en question permanente, à sa capacité à s’adapter aux mutations du monde ?
 Comme le rappelait Hannah Arendt, « les faits sont têtus, mais ils sont sans défense ». Même la vérité, dans un monde numérique saturé, peut être désactivée, noyée ou instrumentalisée. Il ne suffit pas qu’elle soit conservée : il faut encore qu’elle soit comprise, partagée, débattue.
Comme le rappelait Hannah Arendt, « les faits sont têtus, mais ils sont sans défense ». Même la vérité, dans un monde numérique saturé, peut être désactivée, noyée ou instrumentalisée. Il ne suffit pas qu’elle soit conservée : il faut encore qu’elle soit comprise, partagée, débattue.
À ces questionnements s’ajoutent des enjeux éthiques majeurs. Qui définirait ce qu’il convient de préserver comme vérité ? Qui en contrôlerait l’accès et l’interprétation ? La promesse d’une vérité « immortelle » ne risque-t-elle pas de se muer en dogme technologique, verrouillant la pensée dans un corpus figé, potentiellement obsolète ou manipulé ?
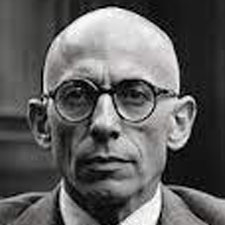 Le philosophe Michel Foucault nous avait avertis : « La vérité est d’ici-bas ; elle est produite par contrainte, elle est produite par des combats, elle est produite par des systèmes de pouvoir. » En d’autres termes, une technologie de vérité sans débat démocratique devient un outil de domination, non de libération.
Le philosophe Michel Foucault nous avait avertis : « La vérité est d’ici-bas ; elle est produite par contrainte, elle est produite par des combats, elle est produite par des systèmes de pouvoir. » En d’autres termes, une technologie de vérité sans débat démocratique devient un outil de domination, non de libération.
L’illusion d’une vérité automatisée est d’autant plus dangereuse que les IA actuelles, notamment les IA génératives, produisent des textes, images ou vidéos qui imitent si bien la réalité qu’ils finissent par brouiller les repères. Une vidéo synthétique ou un faux témoignage généré par algorithme peut imposer une « vérité visuelle » plus convaincante que la réalité. Le risque n’est pas seulement de perdre la vérité : c’est de ne plus pouvoir la distinguer du faux.
En définitive, l’aphorisme du Professeur Zahiri agit comme un garde-fou contre toute tentation de démesure techniciste. Il nous rappelle que la vérité n’est pas une donnée absolue, mais un processus humain, fragile, mouvant, sans cesse réinterprété.
Si la technologie peut être un formidable allié pour conserver et transmettre les savoirs, elle ne peut se substituer à la pensée critique, à la pluralité des points de vue, ni à la dynamique vivante de la quête de sens.
Déjà chez Platon, dans le mythe de la caverne, la vérité n’était pas donnée — elle était un effort, un arrachement aux illusions pour entrevoir la lumière. Même à l’ère des mégadonnées, cet arrachement demeure nécessaire.
La vérité, même conservée dans les mémoires les plus puissantes de nos machines, restera toujours un héritage vivant, à raviver, à discuter, à réinventer. Loin d’être une entité immuable, elle est une flamme fragile, confiée à chaque génération, et dont la transmission reste notre plus grande responsabilité.
Patrice PIARDON
Responsable de communication & Directeur de projet
IKODI IT & DESIGN SOLUTIONS
📞 +243 858 420 774
✉️
🌐 www.ikodi.fr
📍 Kinshasa, RDC
Glossaire des références citées
- Paul Zahiri : Philosophe et politologue ivoirien, dont les aphorismes interrogent la nature humaine, le pouvoir et la vérité dans un contexte africain.
- Hannah Arendt : Philosophe germano-américaine du XXe siècle, spécialiste des régimes totalitaires et de la condition humaine ; elle insiste sur la fragilité des faits face à la manipulation.
- Michel Foucault : Philosophe français, théoricien des rapports entre savoir et pouvoir. Il démontre que les vérités sociales et historiques sont produites par les systèmes de domination.
- Platon (mythe de la caverne) : Allégorie classique de la philosophie grecque selon laquelle les hommes prennent les ombres pour des réalités, et doivent se détacher de leurs illusions pour découvrir la vérité.
- Internet Archive (Wayback Machine) : Projet à but non lucratif visant à archiver le contenu du web pour les générations futures.
- IA générative : Intelligence artificielle capable de produire de nouveaux contenus (textes, images, vidéos) à partir de données d'entraînement. Elle pose des défis majeurs en matière de véracité.


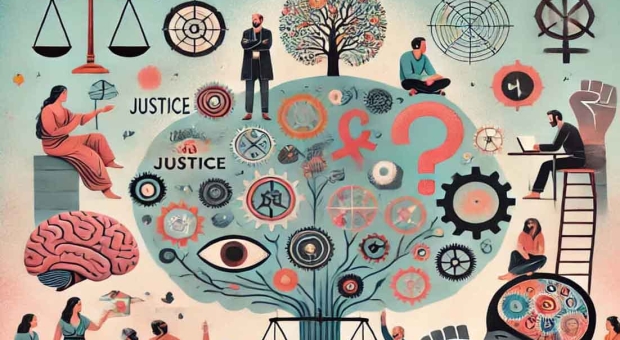

Comments est propulsé par CComment